Le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre. Il est caractérisé par des propriétés physiques, chimiques et biologiques, qui peuvent avoir une influence sur la répartition des êtres vivants.
La genèse et l’évolution du sol dépend de la nature de la roche mère, du climat et de l’influence des êtres vivants.
Le document suivant montre la répartition horizontale des végétaux entre la forêt de Temara et le plateau de Zaer

On observe que le chêne liège pousse sur tous les types du sol sauf le calcaire, ce qui laisse supposer que la nature du sol intervient dans la repartition de cette espèce végétale.
– Quelles sont les caractéristiques du sol qui peuvent influencer la répartition des êtres vivants?
– Quels sont les rôles des êtres vivants dans la genèse et l’évolution du sol?
– Comment peut-on protéger le sol et améliorer sa productivité?
1 – Les propriétés du sol.
1 – 1 – Les propriétés physiques.
a – La Texture du sol:
La texture d’un sol est la répartition granulométrique de ses constituants, c’est à dire les dimensions des éléments solides.

Pour déterminer la texture du sol, on procède à la manipulation suivante:
– On ajoute de l’eau oxygéné à un échantillon de sol dans un bécher, puis on chauffe le mélange pour la destruction de la matière organique.
– On ajoute de l’acide chlorhydrique pour l’élimination du calcaire.
– On ajoute de l’eau et on laisse décanter pendant plusieurs heures.
– La fraction minérale est récupérée puis séchée et pesée.
– On mis la fraction minérale dans une colonne de tamis à ouvertures de mailles décroissantes.
– Après séparation du sable, limon et argile, on pèse chaque fraction pour déterminer le pourcentage des différents éléments minéraux de l’échantillon du sol.
Pour déterminer la texture d’un sol, on se réfère au diagramme en triangle présenté dans le document suivant:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Triangle-texture-sols.png
Ce diagramme s’utilise de la manière suivante :
– On place sur chacun des côtés la valeur en % de la teneur du sol en particules de cette catégorie granulométrique.
– ہ partir de chaque point on trace une droite parallèle à un des côtés du triangle (lignes en traits tirés).
– Le point d’intersection de ces 3 droites indique la texture du sol.
Application:
Le tableau suivant représente les résultats de l’analyse granulométrique de deux échantillons de sol : Sol A et Sol B.
| Argile | Sable | Limon | |
| Sol A | 40% | 50% | 10% |
Sol B | 20% | 20% | 60% |
1 – En exploitant les données du tableau et le triangle des textures, déterminer la texture des deux sols A et B.
b – La structure du sol :
La structure du sol fait référence au mode ou la façon dont les particules du sol (sable, limon et argile) sont disposées les unes par rapport aux autres.
Le document suivant représente les trois grandes structures:
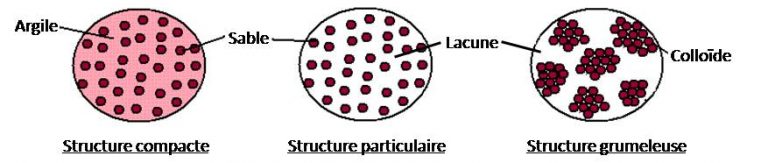
1 – En exploitant le document, décrire les trois structures.
2 – Déduire la structure la plus favorable pour l’agriculture. Justifier votre réponse.
1 – La structure particulaire: les particules sableuses du sol sont libres et n’ont aucune adhérence entre elles.
-La structure compacte: les particules constitutives du sol sont liées avec de l’argile.
– les structures grumeleuses: constituées d’éléments (colloïdes) minéraux et organiques qui constituent le complexe argilo-humique qui retient l’eau utilisable par les plantes.
2 – Les structures particulaires sont filtrantes et sensibles à l’érosion. Les structures compactes sont asphyxiantes et difficiles à travailler. Les structures grumeleuses sont filtrantes, mais sans excès. En particulier, elles préservent bien les réserves hydriques du sol. Elles assurent aussi une bonne circulation de l’atmosphère du sol favorisant la respiration racinienne et propice aux bactéries aérobies.
c – La porosité et la perméabilité:
– La porosité: correspondant à l’ensemble des vides (pores) d’un sol, ces vides sont remplis par des fluides (liquide ou gaz). Elle est liée à la texture du sol.
– La perméabilité: mesure de l’aptitude d’un milieu à se laisser traverser par un fluide, par ex. l’eau. Elle est étroitement dépendante de la texture et de la structure du sol.
Pour mesurer la perméabilité d’un échantillon de sol intact, on soumet une colonne de sol à des conditions particulières, comme la saturation en eau et la pression constante sous eau.

Les résultats vous seront communiqués soit sous la forme de taux de perméabilité (voir tableau 1), soit sous la forme de coefficient de perméabilité (voir tableau 2).

Tableau 1 - FAO

Tableau 2 - FAO
Le coefficient de perméabilité K
K ( m/s ) = Q / S x I
Q = débit ( m3/s ), S = surface (m2) et I le gradient hydraulique.
le gradient hydraulique I = ∆H / L
1 – 2 – Les propriétés chimiques du sol
a – L’acidité du sol
Le pH ( potentiel d’hydrogène ) du sol est une mesure de l’acidité ou de l’alcalinité des sols. Il dépend de la concentration en ions H+.
Pour mesurer le pH du sol on peut utiliser le papier pH ou le pH mètre .


– creuser le sol avec un transplantoir (petite pelle à main) et prélever de la terre à 2-3 cm de profondeur environ, débarrassée des débris éventuels.
– remplir un tube ou un petit bocal en verre à mi-hauteur.
– compléter avec de l’eau distillée.
– mélanger énergiquement après avoir bouché hermétiquement le tube ou le bocal.
– attendre que la terre redescende au fond du récipient, puis mesurer le pH en plongeant dans l’eau le papier pH ou la sonde du pH mètre.
b – Les colloïdes du sol et le complexe argilo-humique
Pour la mise en évidence des colloïdes du sol, on propose les manipulations suivantes:
1. Préparation des colloïdes argileux
a) Mélanger dans un bécher 150mL d’eau distillée et 20 grammes de sol argileux.
b) Laisser décanter les plus grosses particules puis filtrer.
c) Le filtrat obtenu n’est pas limpide, c’est une solution colloïdale d’argile.
d) Verser 10mL de la solution colloïdale dans 2 tubes à essai
e) Ajouter dans le premier 10mL de solution de CaCl2
f) Ajouter dans le second 10mL d’eau de chaux
2. Préparation des colloïdes humiques
a) Mélanger dans un bécher 100mL d’ammoniaque et 20 grammes de sol riche en humus.
b) Laisser décanter les plus grosses particules puis filtrer.
c) Le filtrat obtenu n’est pas limpide, c’est une solution colloïdale d’humates.
d) Verser 10mL de la solution colloïdale dans 2 tubes à essai
e) Ajouter dans le premier 10mL de solution de CaCl2
f) Ajouter dans le second 10mL d’eau de chaux

On peut observer la floculation des colloïdes argileux et la floculation des colloïdes humiques . Les ions Ca2+permettent la formation d’agrégats de particules d’argile (chargées -), de même pour l’humus.
On prépare deux tubes à essai qui contiennent un mélange d’eau distillée, d’argile et d’humus. On ajoute au tube 2 seul des ions Ca+2
| 2 | 1 | tubes |
| Ca+2 | Temoin | les ions ajoutés |
Les résultats obtenus sont indiqués sur le document suivant:

1 – En exploitant les données experimentales, intérpreter les resultats obtenus.
1 – On peut observer que dans le tube témoin, la solution est trouble. Alors que dans le tube 2, la solution est limpide et un dépôt au fond du tube.
– Dans le tube témoin, les colloïdes argile et humus sont dispersés.
– Dans l’autre tube, les ions calcium Ca2+ floculent les micelles d’argile et d’humus. L’ensemble argile-humus-Ca2+ forme le complexe argilo-humique (C.A.H)
La présence d’ions floculants (Ca2+, Mg2+,…) permettent d’associer l’argile et l’humus pour former le complexe argilo-humique (C.A.H) qui constitue un véritable réservoir d’éléments nutritifs pour les plantes qui échange et en permanence des ions avec la solution du sol.

c – L’eau du sol
– Les formes de l’eau dans le sol
Pour determiner les formes de l’eau dans le sol, on propose les expériences suivantes:
– Experience 1: On verse de l’eau sur un échantillon séché du sol jusqu’à saturation, la masse du sol S1 devient m1=159,5g.
– Experience 2: On laisse l’échantillon S1 s’égoutter pendant quelques heures, la masse du sol S2 devient m2= 149 g
– Experience 3: On place une plante dans l’échantillon S2, la plante se développe normalement pendant quelques jours et commence à flétrir. On obtient un sol S3 de masse m3 = 131.5 g
– Experience 4: L’échantillon S3 est placé dans un four à 100°C pendant quelques heures. On obtient un sol S4 de masse m4 = 100 g
1 – En exploitant les expériences, calculer:
a – la masse d’eau perdu lors de l’experience2. (l’eau gravitaire)
b – la masse d’eau absorbée par la plante. (l’eau capillaire)
c – la masse d’eau retenu par le sol aprés le flétrissement de la plante. (l’eau hygroscopique)
2 – Calculer le pourcentage de l’eau retenue par le sol lors de flétrissement de la plante, qui représente le point de flétrissement.
1 – a – la masse d’eau perdu lors de l’experience2
159,5g-149g=10.5g
Il représente l’eau gravitaire (Vg) qui circule librement dans la macroporosité du sol, se déplace essentiellement vers le bas sous l’effet de la gravité.
b – la masse d’eau absorbée par la plante.
149g-131.5g=17.5g
Il représente l’
eau capillaire (VC) qui est retenue sous forme de films assez épais autour des particules terreuses, cette eau est facilement utilisable par la plante.
c – la masse d’eau retenu par le sol après le flétrissement de la plante
131.5g-100g=31.5g
Il représente l’eau
hygroscopique (VR) qui est retenue sous forme de films très minces autour des particules terreuses, cette eau n’est pas absorbable par les racines des plantes.
2 – Le pourçentage de l’eau retenue par le sol lors de flétrissement de la plante.
F = 31.5/131.5 x 100 =23.95%
– La capacité de rétention de l’eau d’un sol :
Dans les expériences précédentes la quantité d’eau retenu par le sol est 149g-100g=49g. Elle représente la capacité de rétention de l’eau du sol.
Le tableau suivant donne la capacité de rétention de l’eau de deux échantillons de sol
Sable grossier | Argile | |
Diamètre des grains | 2mm | inférieur à 2µm |
la capacité de rétention de l’eau % | 1.55 | 27.4 |
3 – En exploitant les données du tableau, déduire la relation entre la capacité de rétention de l’eau et la texture du sol.
3 – On constate que le sol argileux retient beaucoup plus d’eau que le sol sableux.
Plus le diamètre des grains du sol est petit, plus la capacité de rétention de l’eau est grande
2 – L’influence des propriétés du sol sur la répartition des êtres vivants:
2 – 1 – L’influence de la capacité de rétention de l’eau du sol sur la répartition du chêne liège
Pour l’étude de la répartition du chêne liège au niveau d’une une partie de la forêt Maamora, on propose le document 1 qui montre la répartition horizontale de cette espèce .

1 – En exploitant le document 1, dégager le problème scientifique concernant la répartition du chêne liège dans cette région.
Pour résoudre ce problème, on propose les données expérimentales suivantes:
Des plantules du chêne liège ont été implanté dans des horizons sableux à épaisseurs différents en dessus d’un horizon argileux.
Les résultats obtenus sont représentés sur le document 2:
Epaisseur de l’horizon sableux (cm) | Resultat |
0 – 50 | Pas de croissance |
50 -200 | croissance |
| Supérieur à 200 | Pas de croissance |
Le document 3 représente un schéma de la position des plantules selon l’épaisseur de l’horizon sableux.

2 – A partir des documents 2 et 3, interpréter les résultats obtenus et déduire le facteur influençant la répartition du chêne liège dans cette région.
2 – 2 – L’influence du pH du sol sur la répartition des végétaux
Le document suivant montre la répartition horizontale des végétaux entre la forêt de Temara et le plateau de Zaer

1 – Dégager les types de sol sur les quels pousse le chêne liège et où ne pousse pas.
Pour expliquer cette répartition du chêne liège, on propose les données expérimentales suivantes:
– On prépare 3 milieux avec des sols différents et on cultive des plantules du chêne liège dans chaque milieu. Les conditions expérimentales et les résultats sont indiqués sur le tableau suivant:
Milieu | Résultat |
Sol du plateau de Merchouch | Flétrissement des plantules |
Sol de la forêt de Temara | Croissance des plantules |
Sol de la forêt de Temara + calcaire | Flétrissement des plantules |
– On analyse le taux de Fer des plantules de chaque milieu, les résultats sont indiqués sur le tableau suivant:
Origine de la plantule | Taux de Fer |
Cultivée dans le sol du plateau de Merchouch | Carence |
Cultivée dans le sol de la forêt de Temara | Normale |
| Cultivée dans le sol de la forêt de Temara + calcaire | Carence |